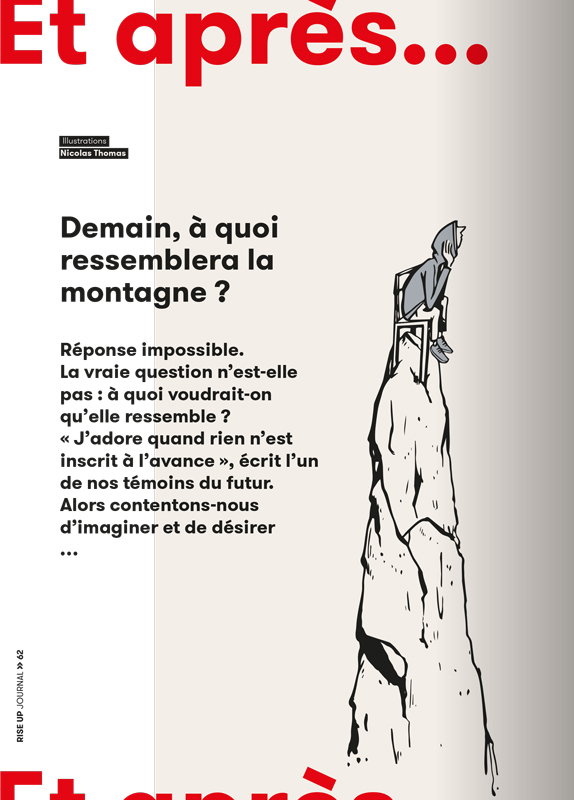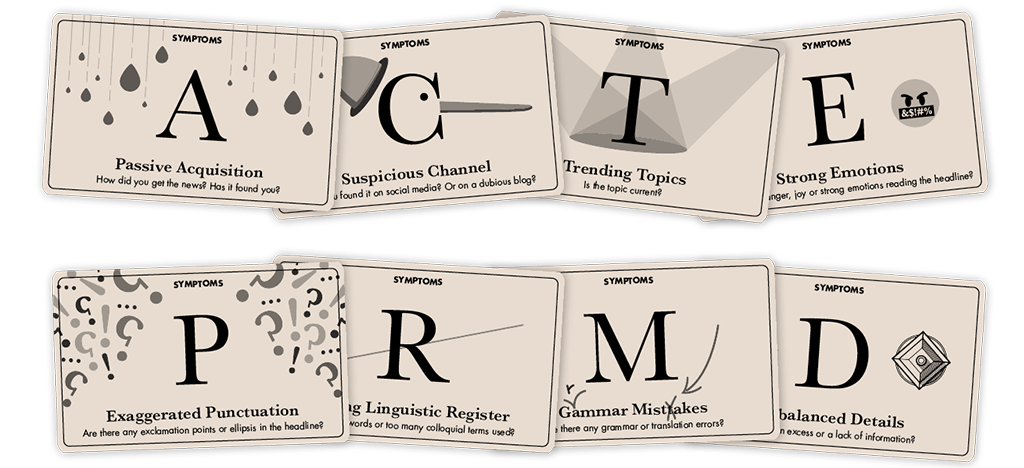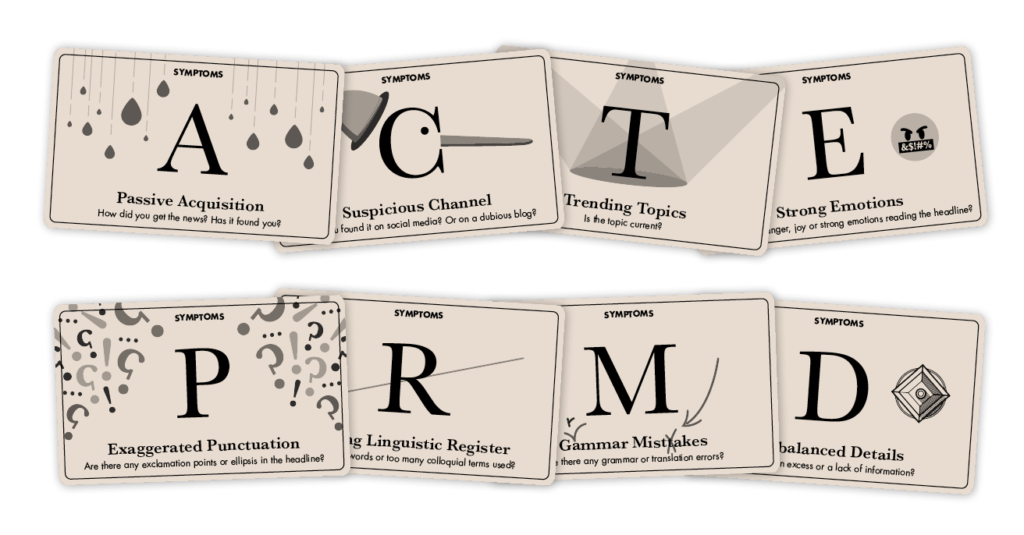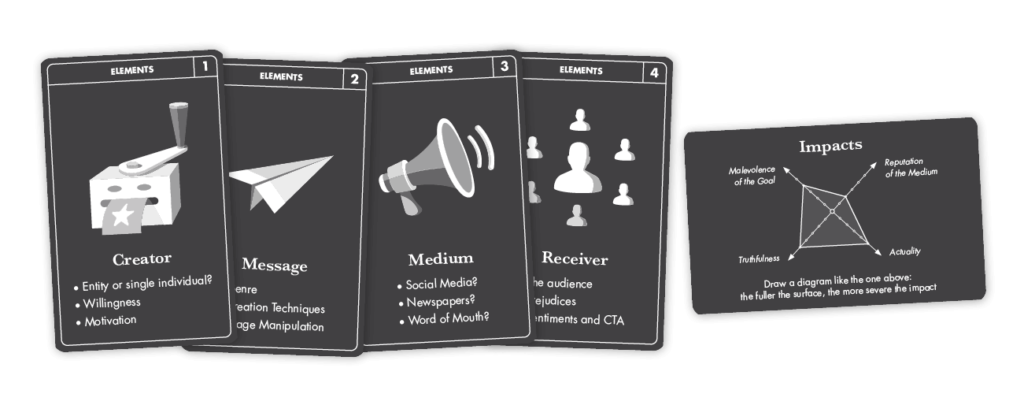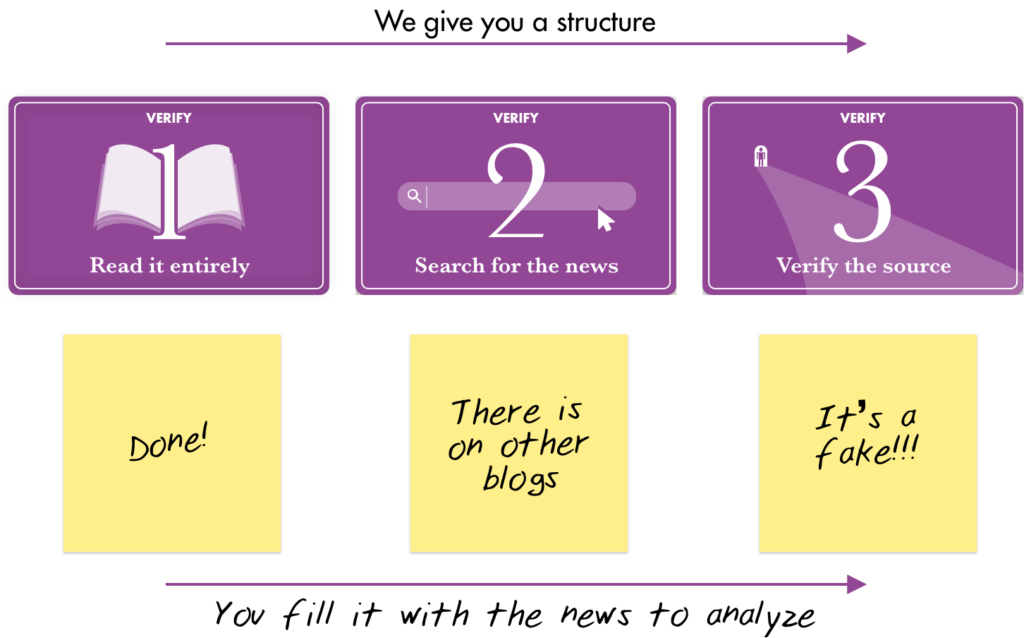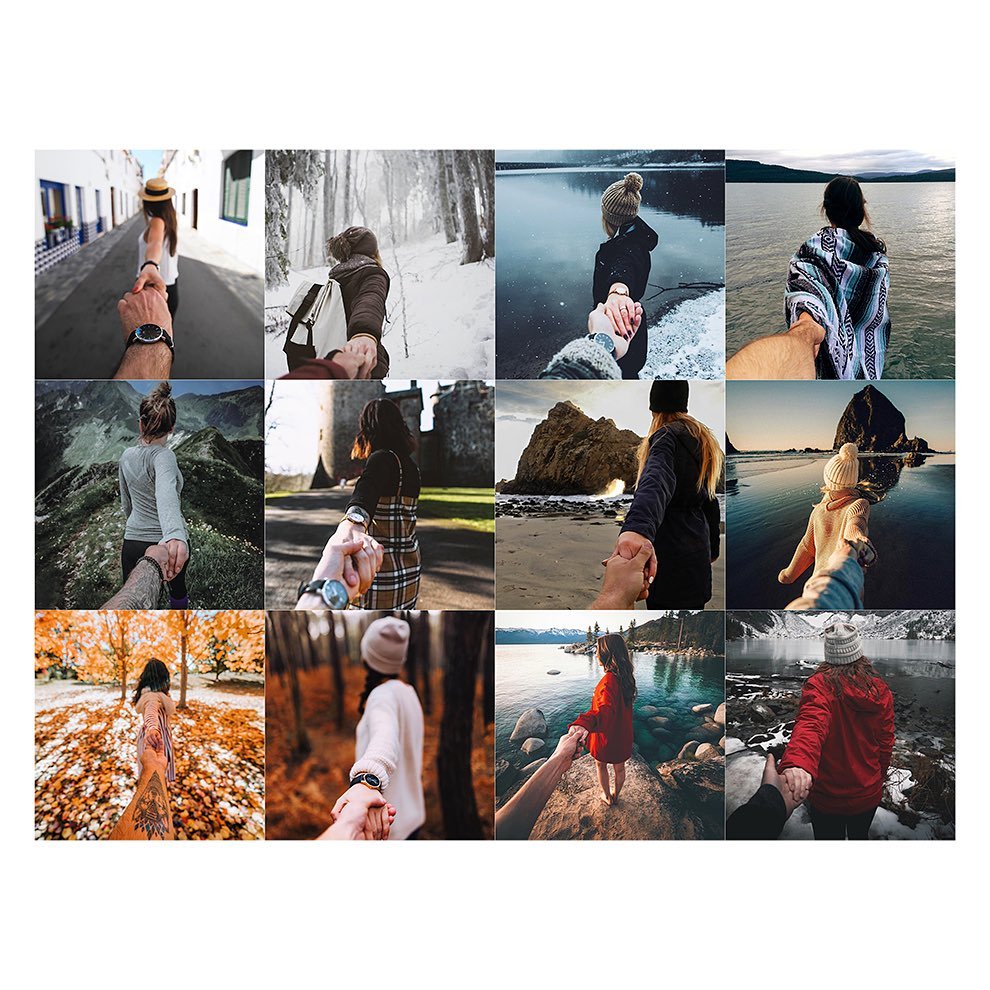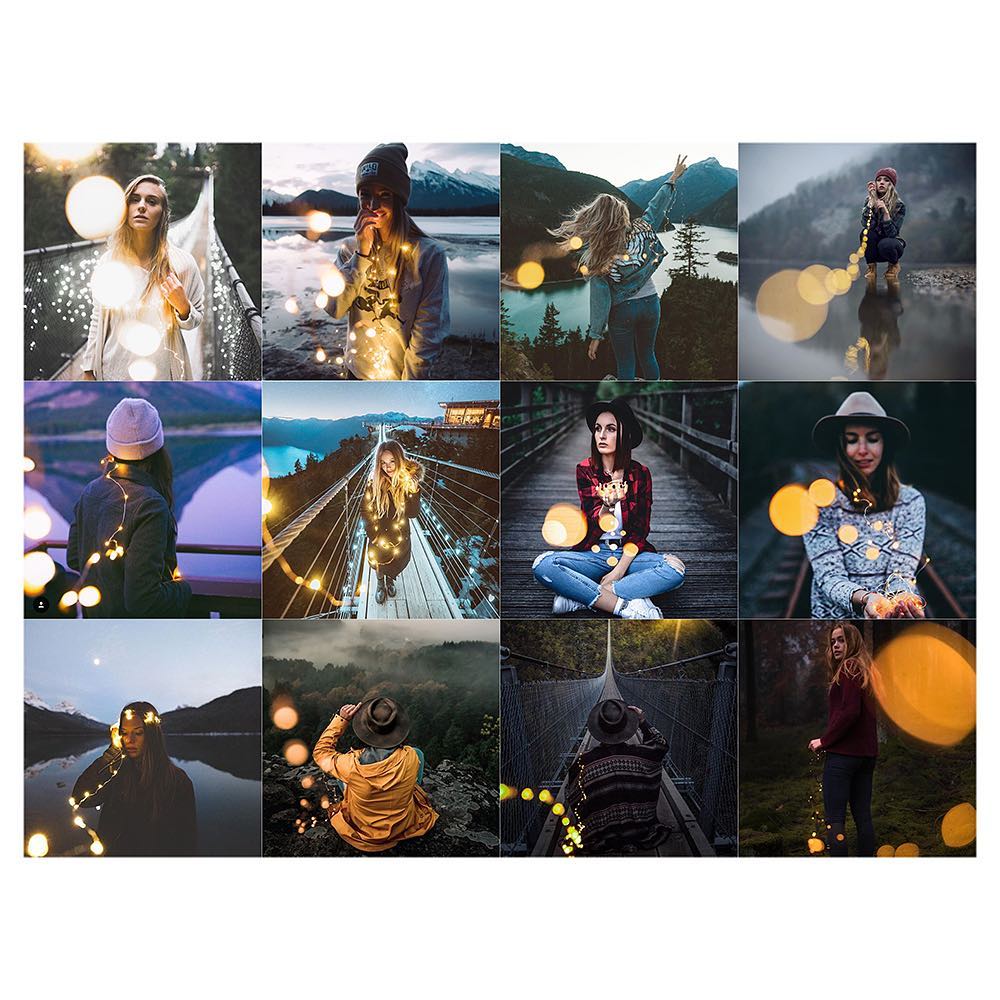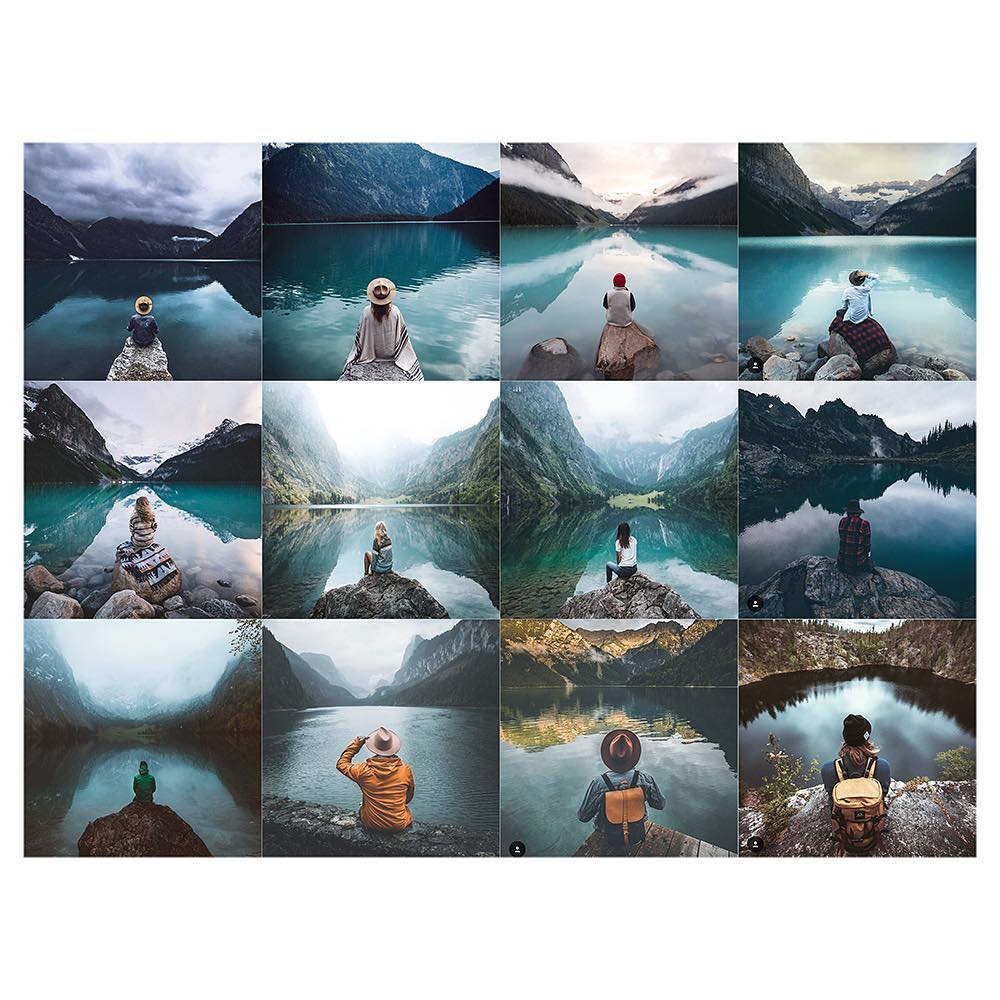La réponse est : pas vraiment. Et ce sont des spécialistes qui le disent. Le développement durable a beau être l’un des thèmes principaux de la communication des marques d’outdoor, la réalité est têtue. Il faudrait un changement radical pour que business de l’outdoor et développement durable soient vraiment compatibles…
Faites plaisir à vos oreilles, écoutez la version podcast, sur votre plateforme habituelle ou ici : http://outdoor-podcast.com/episode3/
Le textile serait, selon certaines études, la deuxième industrie la plus polluante au monde après le pétrole et ces dernières années des rapports ont pointé du doigt la pollution directement liée aux vêtements outdoor. L’industrie de l’outdoor a réagit, ayant bien conscience que son terrain de jeu devait être préservé. Mais entre le green washing(comme par exemple ce duvet recyclé qui fait trois fois le tour de l’Europe et deux fois le tour du monde) et les actions concrètes (l’allongement de la durée de vie des vêtements grâce à la réparation), il est difficile de s’y retrouver. Et surtout, on ne pose jamais la question qui fâche : le business de l’outdoor n’est-il pas en train de courir derrière le mirage du développement durable ?

Benjamin Marias, membre de l’agence Air Coop et consultant sur la question auprès de nombreuses marques de l’outdoor, estime que : “le modèle économique tel qu’il est fait aujourd’hui n’est clairement pas compatible. Produire autant de produits à l’avance, les envoyer à l’autre bout du monde, les vendre le plus massivement possible (…) ce n’est pas suffisant”.
De plus, aujourd’hui, la plupart de nos actions se résument à la réduction de nos impacts écologiques, ajoute-t-il. La clé est de passer d’une économie de réduction d’impact à une économie créatrice d’impact positif. Il cite l’exemple de Grown Skis, fabriqués à partir de chanvre et de bois, cultivés en Italie et produit en Allemagne. “Ici, le ski est régénérateur dans le sens où lors de sa fabrication, le chanvre capte plus de CO2 que le ski n’en émet”.
Le changement ne pourra venir que d’une modification du modèle de production globale et pas seulement à l’échelle de l’outdoor, car selon Benjamin, “c’est possible de mettre au coeur de son modèle économique une dimension écologique et sociale. Sans vision, on continuera à suivre le chemin sur lequel on est”.
“ Je fais le constat un peu amer que nous sommes une génération d’écolos et de responsables développement durable qui a collectivement failli à sa tâche. Il n’y a pas de radicalité dans les mesures mises en place. On est devenus très bons à être mauvais”,renchérit Stewart Sheppard, consultant en développement durable pour le fabricant Gore-Tex.
Selon lui, même le recyclage n’est pas efficace, car “on a beaucoup de difficultés à recycler. Il existe des initiatives qui sont très intéressantes, au niveau des chaussures, des vestes, avec des marques qui font des trucs géniaux, mais on est de l’ordre de 1% de recyclage, voir 0,1% par rapport au volume global de production du produit. Aujourd’hui on n’arrive même pas à recycler tout ce qu’on produit en tant que déchets”. Une belle histoire à raconter mais un effort infime par rapport à la quantité de matériaux utilisée. “Nous ne sommes même pas capables de recycler nos déchets”, ajoute-t-il.
Du côté des solutions, il suggère aux marques de se questionner sur la possibilité de rester profitable sans pour autant être obligé d’accroître la production, avec des solutions de locations ou de leasing de matériel. Le consommateur, lui, peut suivre cette petite philosophie de poche : “acheter moins, payer un peu plus et garder plus longtemps”. Stewart se base sur une étude de l’université de Cambridge qui estime que si on gardait nos vêtements neuf mois plus longtemps, cela aurait un impact positif sur l’environnement.

Garder ses vêtement plus longtemps est aujourd’hui la solution la plus simple et la plus efficace à notre portée à tous. Fabrice Pairot de Fontenay le sait bien puisqu’il a crée l’atelier Green Wolf, situé à Servoz (près de Chamonix), où il répare avec son équipe de couturières les vêtements techniques. “On a participé à une étude qui visait à évaluer si l’aspect réparation était plus intéressant que l’échange et la vente. C’était une étude très large parce qu’elle touchait plusieurs secteurs dont l’automobile. Il était clairement montré que plus on fait durer son vêtement plus réduit son impact sur l’environnement, c’est aussi simple que ça”.
Greenwolf assure le service après-vente de grande marques (mais on peut le contacter en direct) pour donner une seconde vie à une veste en parfait état dont seul le zip est cassé, par exemple. En moyenne, il assure plus de 200 réparations par mois, avec un pic de commandes en hiver. “La plus grande fierté qu’on peut avoir, c’est l’évolution – de mentalité – des marques. Au départ quand une marque venait nous voir, elle pensait qu’il n’y avait que quelques éléments de réparable dans un produit, puis on lui disait ‘mais ça aussi c’est réparable, il ne faut surtout pas le jeter ! Il n’y a quasiment pas de limites à la réparation”

Liv Sansoz est une alpiniste professionnelle et active dans l’association Protect Our Winter: elle est au coeur de notre problématique. Comme elle le montre au quotidien, elle estime que chacun doit agir à sa mesure. “J’ai envie d’être optimiste et dire que oui, ça sera possible dans une certaine mesure. Mais globalement, tant qu’on envisage de faire du profit, on ne s’inscrit pas dans quelque chose de durable. Je pense qu’il y a des gens qui vont faire évoluer les choses et j’ai envie de croire qu’on va pouvoir aller vers quelque chose de plus durable, avec moins d’impact et que tout le monde s’en portera mieux. On vit dans un monde qui ne va pas dans le bon sens et qui en plus s’accélère. Là on a déjà dépassé des seuils irréversibles.
Je ne peux qu’encourager les amoureux de la montagne et de la nature à faire ce qu’ils peuvent, parce que ne rien faire c’est être complice, par défaut”.
Texte : Guillaume Desmurs avec Anouchka Noisillier